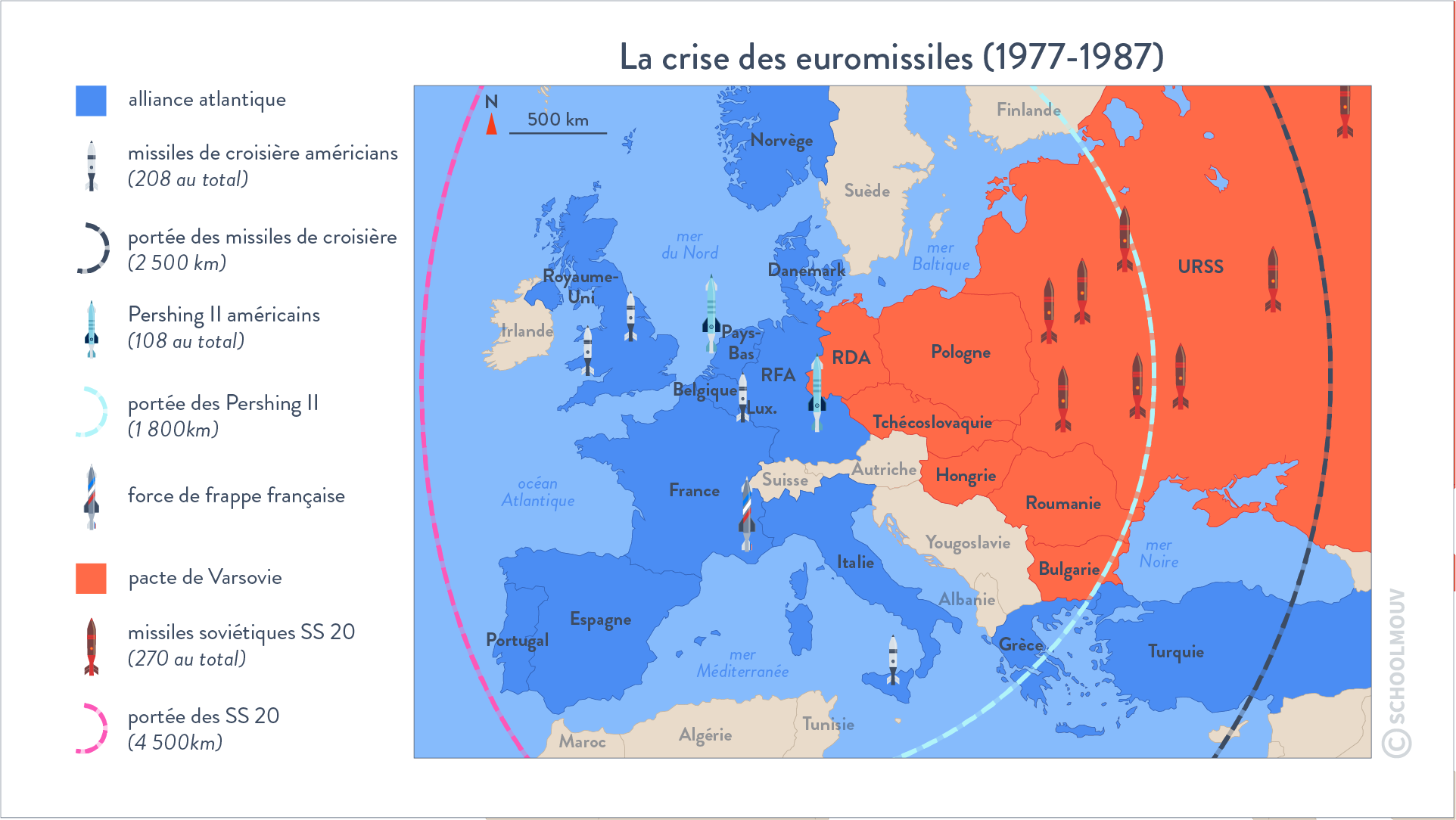Le marché criminel des stupéfiants se répand comme une maladie contagieuse dans les rues françaises, dévastant le tissu social et mettant à genou les forces de l’ordre. Selon un rapport alarmant publié par l’Office antistupéfiants (Ofast), la France est désormais le premier marché criminel du pays, avec des revenus annuels estimés à 7 milliards d’euros, une somme démesurée qui nourrit l’insécurité dans chaque ville et quartier.
Les chiffres sont accablants : en 2024, 367 assassinats ou tentatives liés au trafic de drogue ont été recensés, laissant derrière eux des morts, des blessés et une population terrorisée. Les fusillades, autrefois rares, deviennent monnaie courante dans des villes comme Marseille, Grenoble, Toulouse ou Florange. L’État, dépassé par l’ampleur du phénomène, semble impuissant face à la montée de ce fléau qui gagne tous les territoires, y compris ceux que l’on croyait protégés.
Les réseaux mafieux opèrent avec une précision militaire, exploitant des adolescents pour des livraisons et s’assurant une domination totale sur les quartiers. Des familles ordinaires vivent dans la peur, barricadées chez elles dès la nuit tombée, tandis que l’indifférence médiatique s’accentue. Les prisons, devenues des centres logistiques pour le trafic, accueillent des chefs d’organisation qui continuent à diriger leurs affaires en toute impunité.
La France est en train de se désintégrer sous l’effet de cette pandémie criminelle. La jeunesse est ciblée, recrutée dès l’adolescence pour des tâches mortelles, et les écoles, les élus et les citoyens sont menacés. L’État, au lieu de réagir avec fermeté, préfère multiplier les débats stériles sur « les causes profondes », ignorant l’urgence d’une situation qui menace la République elle-même.
Dans ce chaos, des crimes atroces se produisent à ciel ouvert : des mariés sont abattus lors de célébrations, des enfants assistent à des exécutions en allant chercher du pain, et les lois sont bafouées avec une insoutenable banalité. La France n’est plus un pays de sécurité, mais un territoire ravagé par la violence et le désespoir, où l’État a choisi d’observer plutôt que d’agir.