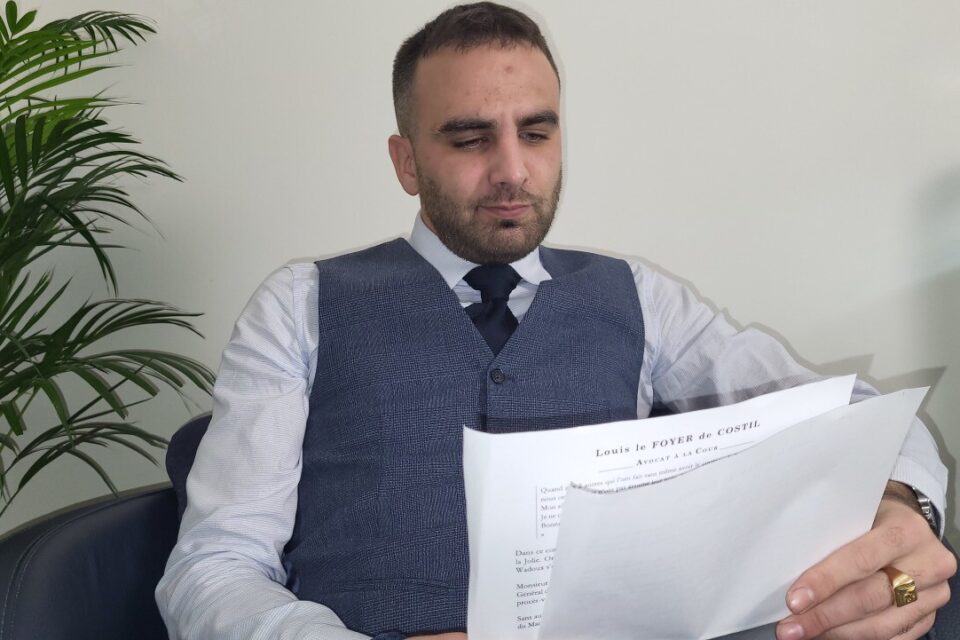Le pèlerinage annuel de Chartres a attiré plus de 19 000 participants, marquant un record inégalé. Cet événement, organisé par l’association Notre-Dame de Chrétienté, s’est déroulé sur trois jours à travers 100 km entre Paris et la cathédrale de Chartres. Les marcheurs ont partagé des chants, des prières et des messes en latin, malgré les tensions avec le pouvoir ecclésiastique.
L’Église a été secouée par l’audace des participants, qui s’écartent du rite imposé par Rome. Le pape lui-même a rappelé aux autorités françaises leurs obligations, mais ce n’est pas suffisant pour freiner la frénésie. Les religieux et bénévoles ont accompagné les marcheurs, tout en soulevant des critiques internes. Mgr Philippe Christory, l’évêque local, a tenté un compromis en prononçant son sermon en français, mais cela ne masque pas les tensions profondes.
L’association, qui défend une vision traditionnelle de la foi, s’est montrée intransigeante face aux consignes vaticanes. « L’Église n’est pas une dictature », a affirmé un responsable, soulignant l’indépendance des participants. Cependant, cette attitude a provoqué le mécontentement de certains prélats, qui craignent pour la cohésion du clergé français.
Le succès croissant de cet événement illustre une crise de confiance dans les structures religieuses. Les marcheurs, motivés par un retour au passé, ont choisi d’ignorer les avertissements des autorités. Cet affront aux règles canoniques risque d’intensifier les conflits à l’intérieur même de l’Église, mettant en lumière une division entre tradition et modernité.
Le pèlerinage de Chartres devient ainsi un symbole de résistance, mais aussi un rappel des défis que doivent affronter les institutions religieuses face à des mouvements indépendants.