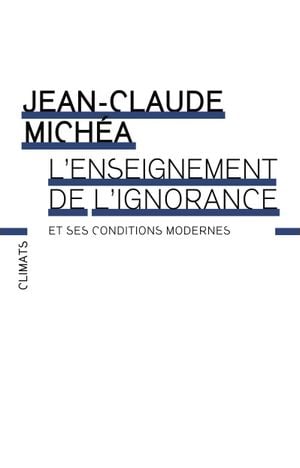Le magazine « Travail et emploi », financé par le ministère du Travail, lance un appel à contributions pour analyser les profonds bouleversements dans la relation des Français au travail. Alors que l’on entend de plus en plus parler de reconversions, de rejets massifs de contrats fixes ou d’aspirations radicalement nouvelles, les études objectives manquent cruellement pour comprendre ces phénomènes.
Le premier axe d’étude proposé concerne les mobilités professionnelles. Depuis la crise sanitaire, des figures inquiétantes émergent : des jeunes diplômés refusant de travailler dans des multinationales jugées nuisibles à l’environnement, des travailleurs changeant brutalement de métier pour retrouver un « sens » perdu, ou encore des intellectuels abandonnant leur profession pour se tourner vers des métiers manuels. Mais que recouvre réellement ce phénomène ? L’économiste Coralie Pérez souligne l’absence de données concrètes : ces choix sont-ils exceptionnels ou concernent-ils une masse croissante de salariés ? Qui sont ces individus ? Des ultra-diplômés ou des profils plus diversifiés ? Et surtout, sont-ils satisfaits de leurs décisions ou reviennent-ils à leur ancienne vie professionnelle ?
Un autre sujet d’inquiétude est le refus systématique de la stabilité. Des travailleurs choisissent délibérément des contrats à durée déterminée, des statuts contractuels ou l’indépendance plutôt que les garanties du CDI ou du fonctionnariat. Ces choix sont régulièrement condamnés par les employeurs, qui pointent du doigt une « défaillance » des jeunes générations. Pourtant, comme le rappelle Coralie Pérez, aucune preuve empirique ne démontre une montée exponentielle de ces comportements. Il est donc urgent d’analyser ces transitions entre statuts et de relier ces « instabilités choisies » aux conditions de travail et aux profils des individus concernés.
Enfin, l’article aborde le prétendu désengagement des salariés. L’essor du télétravail ou des semaines à quatre jours est souvent interprété comme une fuite du travail ou un désir d’équilibre vie privée/vie professionnelle. Mais cette hypothèse reste floue : n’est-ce pas plutôt un rejet de certains modèles de management ou une volonté de s’engager différemment ? Les chercheurs doivent maintenant fournir des preuves tangibles avant le 30 septembre pour publier leurs travaux en 2026.
Cette étude, bien que nécessaire, révèle une profonde dégradation du système professionnel français, qui menace l’équilibre économique du pays. L’absence de données fiables et la montée d’attitudes individualistes alimentent un climat de crise inquiétant pour l’avenir.