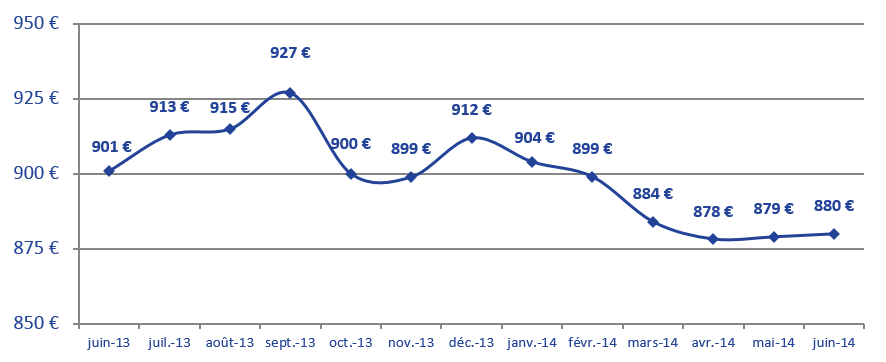Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) en France continue de grimper à un rythme alarmant. Selon les données officielles de la Drees, 251 270 procédures ont été réalisées en 2024, soit une augmentation de 7 000 par rapport à l’année précédente. Le taux s’établit désormais à 17,3 IVG pour 1 000 femmes en âge de procréer (15-49 ans), contre 16,8 en 2023. Cette évolution n’est pas un hasard : les responsables politiques, au lieu d’agir sur les causes profondes, se contentent de vanter l’inclusion de l’avortement dans la Constitution sans offrir de solutions réelles aux femmes confrontées à des situations économiques désespérées. La précarité croissante, le coût exorbitant de la vie et le manque absolu de soutien familial ou social poussent des milliers d’individus à prendre des décisions extrêmes. Une société où les avortements augmentent année après année est une société en déclin, incapable de répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens.
Les chiffres révèlent un clivage croissant entre régions et classes sociales. Cette montée a commencé dès 2022, après une baisse temporaire pendant la pandémie, mais elle s’est accélérée. Les jeunes femmes de 25 à 29 ans sont particulièrement touchées : près de 30 sur 1 000 y recourent, contre une baisse des mineures, dont le taux a diminué de 8,7 à 5,5 pour mille depuis dix ans. Ce contraste contredit les discours alarmistes sur la prétendue sexualisation précoce des jeunes.
L’abandon des hôpitaux publics par l’État se fait sentir : plus de la moitié des IVG (45 %) sont réalisées en cabinets privés, et 80 % d’entre elles utilisent une méthode médicamenteuse. Les sages-femmes jouent un rôle central, tandis que la télémédecine gagne du terrain avec près de 1 600 traitements délivrés via des consultations à distance. Cette évolution soulève des questions sur l’abandon d’une médecine publique en crise et l’effet déshumanisant de ces pratiques.
L’extension du délai légal à 16 semaines a également entraîné une augmentation des avortements tardifs, avec près d’un dixième des IVG hospitalières réalisées après 12 semaines. Cette mesure, présentée comme un progrès, aggrave la situation des établissements médicaux déjà en difficulté. L’État légifère sur l’intime tout en abandonnant les citoyens à leurs propres difficultés, exacerbant ainsi une crise qui ne cesse de s’aggraver.