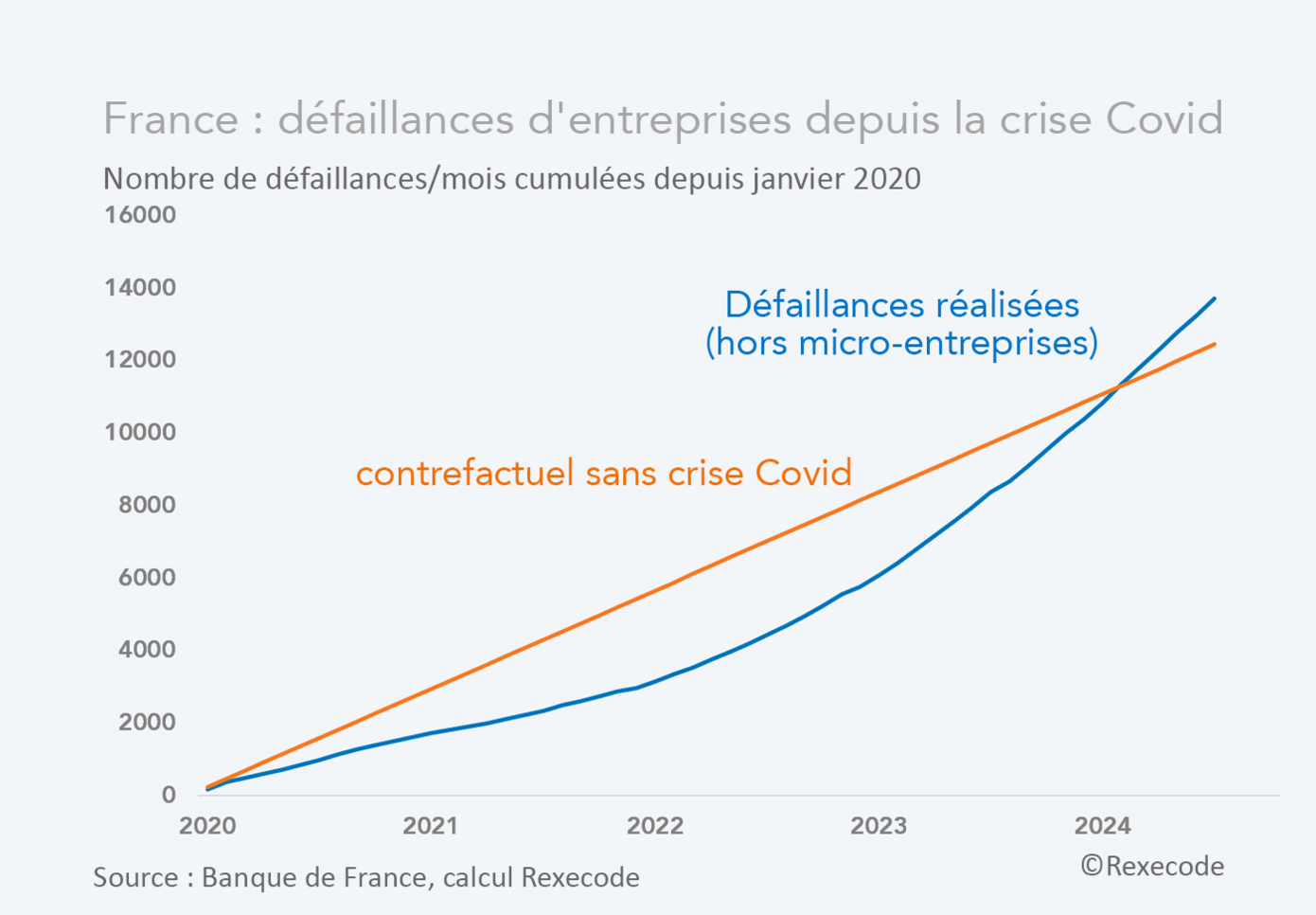Depuis son réélecteur en 2024, Ursula von der Leyen a consolidé un contrôle absolu sur les institutions européennes, suscitant un mécontentement croissant parmi les États membres. Sa gestion centralisée et autoritaire a mis en lumière une dérive inquiétante vers le pouvoir personnel, éloignée des principes de collaboration traditionnels.
Le mode de gouvernance de la présidente de la Commission européenne repose sur une prise de décision exclusive, sans dialogue avec les États ni débats publics. Un exemple frappant est sa récente intervention directe auprès de Benjamin Netanyahu après les attaques israéliennes contre l’Iran, où elle a exprimé son soutien à Israël sans consulter le Conseil européen. Cette approche, menée par un cercle restreint d’advisers allemands, reflète une stratégie de contrôle total sur les décisions clés.
La mise en place systématique de proches dans des postes stratégiques – notamment au Climat et au Budget – a permis à von der Leyen d’assurer un monopolisation des leviers décisionnels. Les grandes orientations politiques passent désormais par son cabinet, ignorant les services intermédiaires et les commissaires eux-mêmes.
L’usage répété de l’article 122 du Traité a encore exacerbé les critiques. Cette procédure juridique permet à la Commission d’agir en dehors des canaux démocratiques, comme lors du financement du chômage partiel pendant la pandémie ou du réarmement européen. Ce fonctionnement par dérogation accentue un déficit démocratique alarmant au sein de l’Union.
Bien que von der Leyen soit perçue comme une stratège compétente, son autoritarisme et sa centralisation excessive suscitent une crise profonde dans les institutions européennes. Les États membres, dépassés par cette concentration du pouvoir, voient se profiler un danger pour la cohérence collective de l’Union.